Introduction
Dans un contexte économique incertain, la défaillance d’une entreprise, même temporaire, peut provoquer un véritable bouleversement dans l’équilibre patrimonial des actionnaires et des investisseurs. Lorsque l’endettement devient insoutenable ou que les perspectives de trésorerie s’assombrissent, la société peut avoir recours à des procédures collectives telles que la sauvegarde ou le redressement judiciaire.
Ces procédures ne sont pas neutres pour les investisseurs : elles autorisent, voire imposent, des opérations sur le capital social, comme des réductions de capital, des augmentations réservées à de nouveaux entrants, ou des conversions de dettes en actions. Pire encore, elles peuvent se traduire par une perte de contrôle, une dilution massive, voire une éviction des actionnaires historiques, au profit des créanciers ou de nouveaux investisseurs.
L’objectif de cet article est de permettre d’avoir une première approche en matière de droit des entreprises en difficulté afin d’identifier les risques juridiques et patrimoniaux majeurs liés à la restructuration d’une société en difficulté et d’en anticiper les effets.
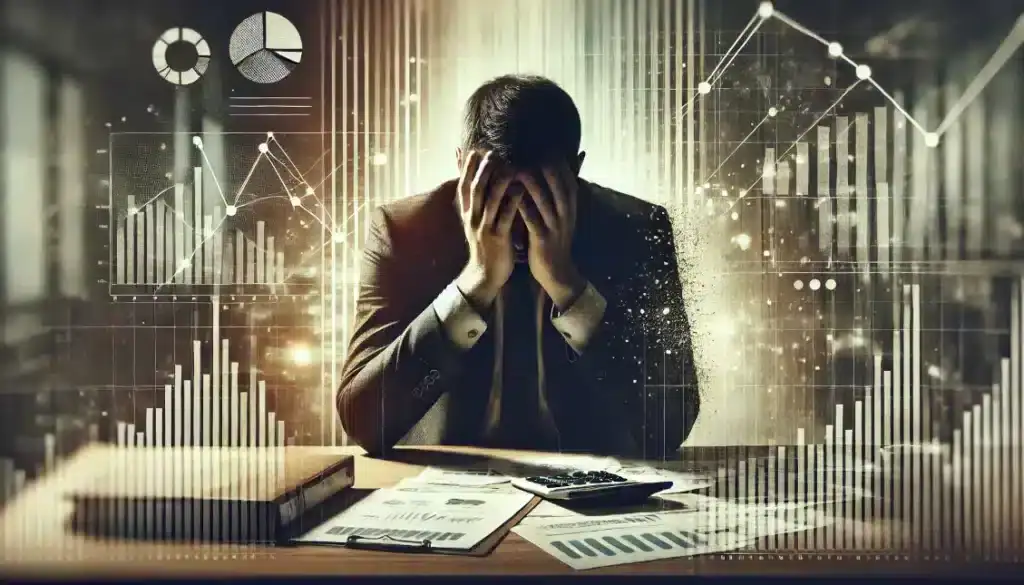
1. Les restructurations du capital dans les procédures collectives
1.1. La procédure de sauvegarde : souplesse et efficacité… mais vigilance pour les associés
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, une entreprise peut engager des opérations sur le capital pour restaurer sa solvabilité. L’article L. 626-3 du Code de commerce permet notamment d’organiser une augmentation de capital en faveur de nouveaux entrants, y compris par compensation de créances.
Exemple pratique : une PME industrielle familiale entre en sauvegarde en raison de tensions de trésorerie. Le plan de redressement prévoit une augmentation de capital de 500 000 €, réservée à deux fournisseurs majeurs qui acceptent d’abandonner 50 % de leurs créances commerciales en échange de titres. Les associés historiques, n’ayant pas les moyens de suivre, se retrouvent dilués à 15 % du capital.
Dans ce type de situation, il est essentiel de conseiller en amont le client sur ses options : apporter des fonds via une holding, négocier des BSA (bons de souscription d’actions), ou prévoir une clause anti-dilution dans un pacte d’associés.
1.2. Le redressement judiciaire : vers des mesures coercitives en cas d’opposition
Lorsqu’une société passe en redressement judiciaire, le législateur permet d’aller plus loin. L’administrateur peut forcer la main aux actionnaires récalcitrants, soit en votant à leur place, soit en sollicitant la cession forcée de leurs titres.
Exemple pratique : une société de services dans le secteur du numérique fait l’objet d’un plan de redressement. L’un des fondateurs, détenant 40 % du capital, refuse de voter l’augmentation prévue. L’article L. 631-19-2 du code de commerce permet au tribunal d’ordonner la cession forcée de ses actions au profit d’un investisseur de retournement, à un prix déterminé par expertise.
Il est alors fondamental de mettre en place des clauses statutaires ou contractuelles prévoyant les modalités de sortie, et de prévoir des évaluations indépendantes des titres en cas de désaccord.
2. Créanciers, obligataires et détenteurs de titres : une nouvelle hiérarchie d’intérêts
2.1. L’apparition des classes de parties affectées : une logique économique de répartition
La restructuration par classes de parties affectées repose sur une vision économique de la valeur résiduelle de l’entreprise, et non sur les droits juridiques « historiques » des actionnaires ou créanciers.
Exemple pratique : une entreprise logistique présente un actif net évalué à 10 M€, pour 15 M€ de dettes. Elle constitue trois classes : créanciers garantis (banques), chirographaires (fournisseurs) et actionnaires. Le plan prévoit un abandon partiel des créances, une conversion partielle des dettes en capital, et une dilution des actionnaires à 5 %. Malgré leur opposition, le tribunal valide le plan car les conditions du best interest test sont respectées.
Pour les investisseurs, cela signifie qu’il faut anticiper la valeur “liquidative” potentielle de l’entreprise, pour arbitrer entre maintien au capital, sortie, ou transformation de la créance en action.
2.2. Les porteurs de titres donnant accès au capital : attention aux faux-semblants
Les titulaires d’obligations convertibles (ORA, OCA, etc.) doivent faire preuve de vigilance : leur statut hybride entre créancier et futur associé les place dans une zone d’incertitude.
Exemple pratique : un client a souscrit des ORA émis par une société immobilière, avec une échéance à 3 ans. À la suite d’une procédure de sauvegarde, le plan prévoit la conversion obligatoire des ORA en actions. Le client devient actionnaire, mais avec une valeur fortement diluée, et sans dividende prévisible.
Cela invite à structurer l’investissement initial en préservant la faculté de non-conversion, ou à prévoir des clauses de protection dans le contrat obligataire (clauses de rachat anticipé, de non-subordination, etc.).
3. Conséquences patrimoniales pour les investisseurs et associés familiaux
3.1. Dilution massive et perte de contrôle
Les restructurations peuvent se traduire par une perte totale du contrôle de l’entreprise par les associés historiques. Les nouveaux entrants (souvent des créanciers) imposent leurs conditions.
Exemple pratique : un groupe familial possède une société industrielle détenue via une holding patrimoniale. La société fille entre en procédure collective et le plan prévoit une triple augmentation de capital, réservée à un groupement de créanciers. La part du groupe familial tombe de 65 % à 0,04 % du capital. Le plan est validé malgré leur vote négatif.
Ce cas met en évidence l’importance de l’ingénierie en amont : structuration en holding, éventuelle transformation des titres en actions de préférence, protection via pactes ou statuts.
3.2. La transmission et la stratégie patrimoniale en question
Ces opérations peuvent aussi compromettre une stratégie de transmission ou de défiscalisation, notamment dans les cas de pactes Dutreil.
Exemple pratique : un client a transmis à ses enfants, sous pacte Dutreil, des titres d’une société commerciale valorisée 1,5 M€. Après un redressement judiciaire et un coup d’accordéon, la société est recapitalisée à 200 000 €, et le client ne détient plus que 2 % des parts. Le respect des conditions du pacte devient incertain, et la remise en cause des exonérations fiscales menace.
Il convient alors de prévoir une clause de substitution d’actifs dans les engagements de conservation ou de réorganiser la détention via une société interposée pouvant participer à l’augmentation.
Conclusion
Les procédures collectives sont loin d’être anodines pour les actionnaires et créanciers. Elles constituent un moment charnière où les équilibres capitalistiques, contractuels et patrimoniaux peuvent être profondément modifiés. Face à une augmentation de capital imposée, une cession forcée de titres, ou un vote en classe qui se substitue à une assemblée générale, le risque patrimonial est majeur.
La vigilance juridique et fiscale en amont, mais aussi la réactivité dans la phase procédurale, permettent de limiter la casse, voire d’identifier des opportunités : repositionnement au capital, renforcement de la détention via un véhicule structuré, ou transformation stratégique d’une créance en action.






